Le Made in France, entre marque et label
C’est quoi le Made in France ?
Le « Made in France » est enfin à l’honneur depuis quelques temps, à tel point qu’un salon du Made in France a lieu chaque année en Novembre à Paris.

Véritable succès depuis plus de dix ans, le « MIF » est devenu le plus grand évènement dédié à la fabrication française dans les secteurs Maison et Décoration, Mode et Accessoires, Beauté et Bien-être, Gastronomie et Tourisme.
Plus de 1000 exposants, 500 journalistes et une fréquentation avoisinant les 100 000 visiteurs qui font du salon Made in France un moment idéal pour travailler son image et sa visibilité, générer un CA substantiel en vente directe, procéder à sa veille technologique et concurrentielle, alimenter sa créativité, étoffer son réseau de partenaires.
Et c’est une bonne chose car la production française souffre et doit être soutenue.
Certes, 85 % des Français disent acheter des produits « Made in France » selon une étude réalisée en 2023 par Opinion Way pour la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Cependant, un décalage grandissant existe entre l’intention d’achat, la disposition à payer devant le prix, la confiance portée à l’étiquette, et, parfois même, le lien réel du produit acheté avec son origine supposée.
Alors, de quoi parle t-on quand on parle de « Made in France » ? S’agit-il d’une marque, d’une labellisation ? Un étiquetage fiable pour le consommateur est donc nécessaire.
Nous vous proposons de faire le point sur la question dans ce billet qui passera en revue les différentes mentions et acronymes liées à l’origine de fabrication pour tenter d’y voir un peu plus clair !
« Made in France », ou « Fabriqué en France »
Il s’agit d’une simple mention, mais non d’un label. Toute entreprise peut apposer ce marquage sur ses produits, ses étiquettes ou emballages. Un logo spécifique a été créé en 2021 par France Industrie mais tout autre logo peut être utilisé.

Il n’y a pas de procédure spécifique à respecter en amont pour s’en prévaloir, bien que les règles du code de la consommation en encadrent l’utilisation.
Le produit en question doit :
✅ tirer une part significative de sa valeur d’une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France et
✅ avoir subi sa dernière transformation substantielle en France.
Ces terminologies sont assez larges et peuvent être sujettes à interprétation.
Pour éviter la sanction de marquage frauduleux en cas de contrôle par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) pour les produits exportés, l’expertise de cette dernière peut être sollicitée en amont pour avis. C’est la procédure IMF, « indication Made in France ».
Le « Made in France » n’est donc pas un label mais un simple marquage.
Qu’est-ce qu’un label ?
Le label est un sceau attestant de la conformité d’un process avec un cahier des charges établi par une instance publique (Etat, INPI) ou privée (fédération de filière, association professionnelle…). Il est attribué après un audit rigoureux par un organisme habilité à le mener et indépendant des intérêts privés.
Concernant le fabriqué en France, un seul label existe à ce jour : le label « Origine France Garantie« .
Origine France Garantie
C’est un label créé par l’association ProFrance en 2011 sur l’impulsion d’Arnaud Montebourg et d’Yves Jégo.

Délivré après certification par un organisme indépendant (Afnor, Veritas…), il permet aux entreprises d’utiliser le logo spécifique « Origine France Garantie », qui assure aux consommateurs la traçabilité du produit si 2 conditions objectives sont réunies :
✅ le lieu où le produit prend sa forme distinctive est situé en France
✅ 50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France
Le lieu de la forme distinctive ?
Pour les produits naturels : le lieu en France concerne l’extraction, la récolte ou la croissance intégrale du produit, pour les végétaux. Celui où l’animal est né, a été élevé et abattu, pour l’élevage.
Pour les produits transformés : le lieu en France concerne les ingrédients dont les noms apparaissent dans la dénomination de vente et dans la dénomination commerciale du produit, mais aussi l’origine de l’ingrédient principal, quel que soit son poids dans la recette, et de tous les ingrédients représentant plus de 30% de la recette. Et enfin les opérations de préparation, de transformation et de conditionnement.
Le prix de revient unitaire ?
◼︎ Le prix du produit s’entend en sortie d’usine, d’atelier ou d’exploitation. Les coûts liés à la recherche et au développement sont pris en compte, pas ceux liés à la commercialisation. Le niveau de 50% est le minimum ; certains secteurs imposent que la proportion du prix soit plus importante pour prétendre au label.
◼︎ Pour le textile, la totalité de la confection – coupe, montage, finition – doit être réalisée en France. Une chemise dont 60% du prix de revient unitaire est acquis en France mais dont une partie est délocalisée ne peut bénéficier du label.
◼︎ Un appareil électroménager conçu, dessiné, assemblé et fini en France mais dont la part française du prix unitaire représente seulement 45% du prix total (composants importés par exemple) ne peut pas prétendre au label.
◼︎ Un plat cuisiné à base de viande préparé en France, avec un prix de revient unitaire français supérieur à 50%, mais dont la viande, ingrédient principal, n’est pas d’origine France, ne peut pas prétendre au label.
D’autres labels et marquages liés à la provenance géographique sur une partie du territoire français existent. En voici un tour d’horizon !
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
Ce label est le seul à être attribué par l’Etat pour 5 ans à des entreprises qui maintiennent des savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Il prend en compte la détention d’actifs spécifiques, le savoir-faire rare, la haute technicité ou l’ancienneté de l’implantation géographique.
Plusieurs secteurs d’activité sont concernés comme les fournitures, équipements et matériaux, la culture et la communication, l’architecture et le patrimoine bâti, les loisirs et les transports, la gastronomie, les arts de la table, et bien-sûr l’ameublement, la décoration, la mode et la beauté qui sont les plus représentés (36% du total).
Aujourd’hui, plus de 1000 entreprises sont titulaires de ce label, dont 83 en Occitanie !
France Terre Textile
Créé en 2008 par les producteurs de textile français, ce label est délivré par un organisme indépendant adossé à l’Institut Français du Textile et de l’Habillement qui en vérifie la validation chaque année.

Il garantit au consommateur que 75% au minimum des étapes de fabrication d’un produit textile ont été effectuées en France selon des critères de fabrication en circuit court, de qualité et RSE dans un des 6 bassins textiles de tradition : les Vosges, l’Alsace, le Nord, Rhône-Alpes Auvergne, Troyes Champagne et le Sud.
Ce sont + de 150 entreprises qui peuvent s’en prévaloir, comme les établissements tarnais Jean Ferrié à Soual ou les Tissages d’Autan à Sainte-Affrique-les-Montagnes.
Indication géographique Protégée

Originellement, le label “Indication Géographique” homologué par l’INPI consacre un savoir-faire et une production agricole, agroalimentaire ou viticole dont une partie du processus de fabrication ou la notoriété est rattachée à une zone géographique spécifique, comme le jambon de Bayonne, les ravioles du Dauphiné, la brioche vendéenne, l’anchois de Collioure, la tomme de l’Aubrac…
Depuis 2014, le label peut aussi homologuer des produits manufacturés comme le granit de Bretagne ou la porcelaine de Limoges.
AOP et AOC
L’Appellation d’origine protégée (AOP) est un sigle européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. Toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique qui donne ses caractéristiques au produit.
En France, près de 500 produits sont référencés comme le camembert de Normandie, le Roquefort, la châtaigne d’Ardèche, la noix de Grenoble, la lentille verte du Puy, l’olive de Nîmes, la Blanquette de Limoux… Découvrez l’histoire et les enjeux du Roquefort, joyau de la gastonomie d’Occitanie et premier fromage protégé de l’histoire de France !
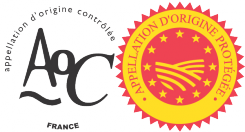
L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape dans l’obtention du label européen AOP et ne peut plus figurer sur les produits une fois qu’ils sont enregistrés comme AOP, à l’exception des vins.
L’AOC peut aussi être attribuée à des produits qui ne sont pas concernés par la réglementation européenne de l’Appellation d’origine protégée (AOP), comme les produits de la forêt.
Sud de France
« Sud de France, l’Occitanie » est une marque créée par la Région Occitanie en 2006 pour permettre à tous les producteurs, agriculteurs, maraîchers, éleveurs, vignerons, fromagers, pêcheurs de référencer leurs produits et d’apposer le logo distinctif sur leurs éléments de communication.

L’adhésion est gratuite et se fait sur le site, délivrée pour 3 ans reconductibles, après validation de la conformité à un cahier des charges. La provenance des matières premières, des sites de transformation et des savoir-faire doit être d’Occitanie.
Depuis 2018, 3 segments de labellisation se côtoient : « Excellence » pour les produits également labellisés IGP, AOC ou AOP, et Label rouge ; « Bio » ; le label originel violet pour tout le reste des produits.
Ce sont 15 000 produits et 2000 professionnels qui sont ainsi référencés gratuitement sous cette belle marque, également portée par de dynamiques campagnes de communication !
—
Qu’il soit label certifié ou simple marquage, l’étiquetage est certes un actif stratégique en matière de marketing et de communication.
Mais une question de fond se pose néanmoins : comment soutenir notre économie sans ajouter des couches d’obligations et de procédures onéreuses ?
Car au-delà de la rigueur drastique des process de production, les marquages et certifications ont un coût : de 350 € pour une démarche IGP à plusieurs milliers d’euros à renouveler régulièrement pour les certifications.
Des sommes auxquelles il faut ajouter le temps et l’énergie mobilisés, ainsi que la crainte de se faire retoquer, de perdre son précieux label ou de voir peser une présomption d’inauthenticité sur ses produits face au concurrent en son absence…
On aimerait mieux soutenir nos fabrications sur le plan national pour que ces protections ne soient pas le fait de démarches plus ou moins individuelles, rendues excessivement contraignantes par les législations européennes, mais que le prix à payer soit plus franchement reporté sur les importations et les contrôles sur les entreprises frauduleuses qui pratiquent le « francolavage ».
—
▶️ Si cet article vous a plu, vous pouvez télécharger sa synthèse en carrousel PDF
Et vous, avez-vous d’autres labels ou marques territoriales à partager ?
Si vous êtes aussi, comme nous chez Kalliopê, attachés à une communication engagée au service du Made in France, venez échanger avec nous sur Linkedin !






